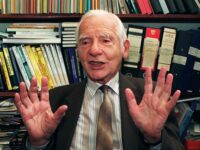Le 8 mars 2025, dans une annonce soigneusement orchestrée, la Corée du Nord a levé le voile sur un projet militaire d’envergure : la construction de son tout premier sous-marin à propulsion nucléaire. Ce nouveau navire nord-coréen, capable de transporter jusqu’à dix missiles balistiques stratégiques, s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer les capacités militaires du pays malgré un isolement économique et technologique sévère.
Au-delà d’un saut technologique, ce sous-marin incarne une transformation doctrinale nord-coréenne à travers laquelle le régime de Kim Jong Un affirme son intention de faire de la dissuasion maritime un pilier central de sa stratégie militaire et de sa marine « une force d’élite dotée de l’arme nucléaire ». Surtout, ce projet, potentiellement soutenu par la Russie, intervient dans un contexte de tensions géopolitiques exacerbées et soulève des questions cruciales sur la prolifération nucléaire et les mécanismes de désarmement.
Une ambition longtemps mûrie
L’annonce de mars 2025 n’est pas un coup d’éclat isolé. Depuis son premier essai nucléaire en 2006, la Corée du Nord s’inscrit dans une trajectoire méthodique de renforcement militaire, étendant ses capacités balistiques et nucléaires – avec notamment un test de lancement de missiles de croisière stratégique en mer Jaune à la fin du mois de février.
En 2023, déjà, la Corée du Nord avait annoncé un sous-marin nucléaire d’attaque tactique, une affirmation accueillie avec scepticisme par les experts internationaux qui y voyaient un modèle diesel modifié. Cependant, le nouveau projet annoncé semble attester une percée technologique bien plus crédible, principalement grâce à une possible assistance technologique russe en échange de soutien militaire dans le conflit en Ukraine.
Ce changement de cap intervient alors que la marine nord-coréenne, jusqu’ici essentiellement composée de sous-marins conventionnels vieillissants (70 à 90 unités), était cantonnée à des rôles côtiers et défensifs. Doté d’une propulsion nucléaire, le nouveau navire pourra opérer en immersion prolongée, contourner les dispositifs de surveillance régionaux et lancer des frappes stratégiques à grande distance. Il transforme ainsi la nature même de la menace nord-coréenne, la rendant plus mobile, plus furtive et donc plus difficile à neutraliser. L’introduction d’un submersible nucléaire permettrait en effet à Pyongyang de projeter une menace permanente et mobile, capable de frapper des cibles à plusieurs milliers de kilomètres. Cette évolution s’accompagne d’une modernisation accélérée des missiles balistiques, dont le Hwasong-18 à carburant solide, testé à trois reprises en 2023.
Une avancée technologique sous influence
Pourtant, la construction d’un sous-marin nucléaire opérationnel représente l’un des défis technologiques les plus complexes du domaine militaire. Il ne suffit pas d’en assembler les pièces : il faut maîtriser une série de savoir-faire ultraspécialisés, depuis la miniaturisation d’un réacteur nucléaire jusqu’à la conception d’une coque résistante aux pressions abyssales. Il faut aussi garantir la stabilité des systèmes d’armement embarqués, assurer la furtivité acoustique et développer des capacités de navigation avancées.
La Corée du Nord, bien qu’ambitieuse, ne possède pas l’ensemble de ces compétences de manière autonome. Ce qui rend son projet plausible, et surtout préoccupant, c’est l’hypothèse d’un appui extérieur. Plusieurs experts convergent vers une même conclusion : Moscou aurait discrètement offert une assistance déterminante à Pyongyang, en échange de livraisons d’armes conventionnelles pour soutenir son effort militaire en Ukraine. Ce soutien technologique prendrait la forme de transferts de composants sensibles, de plans techniques et d’une assistance directe d’ingénieurs russes auprès des équipes nord-coréennes.
La Russie, forte de son expertise historique en matière de sous-marins nucléaires, dispose en effet de tous les éléments nécessaires pour aider Pyongyang à surmonter ses obstacles technologiques : réacteurs miniaturisés, matériaux résistants aux radiations, systèmes de refroidissement, dispositifs de lancement de missiles sous-marins. Une telle coopération, en rupture flagrante avec les engagements internationaux sur la non-prolifération, alimente les inquiétudes des chancelleries occidentales. D’autant que le rapprochement entre Moscou et Pyongyang semble s’accélérer avec la visite du secrétaire du Conseil de sécurité russe et ancien ministre de la Défense Sergueï Choïgou en Corée du Nord ce 21 mars.
Les abysses de la prolifération
Au-delà de ses implications régionales immédiates, le projet nord-coréen soulève une problématique plus large : celle de la prolifération horizontale des technologies nucléaires et de leur dissémination à travers des canaux officieux. Si un État aussi isolé que la Corée du Nord parvient à se doter d’un sous-marin nucléaire, avec l’aide d’un autre membre permanent du Conseil de sécurité, cela envoie un signal inquiétant à d’autres pays en quête de puissance.
Le précédent est dangereux. Il démontre que les sanctions internationales peuvent être contournées, que les traités multilatéraux peuvent être contrecarrés, et que l’acquisition de technologies stratégiques reste possible par la voie diplomatique détournée, par le marché noir, ou par le cyberespionnage. La Corée du Nord a d’ailleurs prouvé sa redoutable efficacité dans ce domaine : entre 2022 et 2024, ses cyberopérations auraient permis de détourner près de 1,7 milliard de dollars en cryptomonnaies et technologies sensibles, largement réinjectés dans ses programmes militaires.
L’Iran, parmi d’autres, observe de près la trajectoire nord-coréenne. Téhéran développe lui aussi, depuis 2022, un programme sous-marin discret. Le succès de Pyongyang pourrait offrir à d’autres États un modèle à suivre, rendant d’autant plus urgente une réponse internationale coordonnée.
Une région en alerte maximale
L’annonce nord-coréenne a provoqué une onde de choc immédiate chez ses voisins. En Corée du Sud, le gouvernement a confirmé le renforcement de sa propre flotte sous-marine, avec l’accélération du programme Dosan Ahn Changho, conçu pour embarquer des missiles à lancement vertical. Le Japon, lui, envisage de doubler son budget militaire d’ici 2027, tout en investissant massivement dans la guerre sous-marine, notamment par le développement de drones sous-marins autonomes. En Asie du Nord-Est, la course aux armements, longtemps contenue, semble désormais relancée.
Les Etats-Unis aussi devront adapter leur posture de dissuasion, l’émergence d’un vecteur sous-marin obligeant les Américains à considérer des frappes potentielles venues de l’océan Pacifique ou près des côtes alaskaines, au-delà des zones de surveillance classiques. Cela pourrait impliquer un redéploiement accru de destroyers – y compris japonais – équipés du système Aegis et de satellites de surveillance.
Une dissuasion asymétrique et risquée
Pour Pyongyang, le pari est clair : garantir sa survie politique en rendant toute attaque préventive occidentale inenvisageable. Le sous-marin nucléaire, par sa mobilité et sa discrétion, permettrait d’assurer une capacité de « seconde frappe » : même en cas de destruction totale de ses installations terrestres, la Corée du Nord pourrait riposter depuis un point inconnu des océans.
Mais cette logique de dissuasion repose comme toujours sur un terrain fragile. Pyongyang n’a pas encore démontré sa capacité à maintenir un tel système en conditions réelles, ni à le contrôler efficacement. Un accident nucléaire à bord, une défaillance du système de lancement, ou même une mauvaise interprétation d’un mouvement militaire adverse, pourraient provoquer une escalade rapide. En 2017, une fuite radioactive sur le site de tests de Punggye-ri avait déjà mis en lumière les failles de sécurité internes du pays. Par ailleurs, la doctrine nord-coréenne repose sur un usage potentiellement offensif de l’arme nucléaire. Le régime n’a jamais renoncé explicitement à la première frappe, ce qui augmente les risques de confrontation armée en cas de malentendu ou de provocation.
Surtout, la dissuasion nucléaire repose sur l’idée que la peur d’une riposte annihilatrice empêche toute attaque. Mais cette logique, en apparence stabilisatrice, est en réalité profondément dangereuse et illusoire. Elle dépend de décisions humaines, de systèmes techniques complexes et de communications sans faille, dans un monde où l’erreur technique ou humaine, le malentendu ou l’escalade incontrôlée restent possibles. En outre, plus les arsenaux se diversifient – en se déployant sur des plateformes mobiles comme les sous-marins –, plus la chaîne de commandement devient vulnérable à des défaillances humaines ou techniques. La dissuasion nucléaire, loin de garantir la paix, impose donc à l’humanité une forme de sécurité conditionnelle, suspendue en permanence au bon fonctionnement de systèmes complexes, au sang-froid de dirigeants, et à l’absence d’erreur. En d’autres termes, elle est une paix armée, dont le coût ultime pourrait être la destruction mutuelle.
Un désarmement mondial en panne
Face à cette montée en puissance nord-coréenne et dans un contexte de tensions géopolitiques exacerbées par le jeu dangereux du Président des États-Unis Donald Trump, la communauté internationale se trouve une fois de plus désarmée. Les instruments traditionnels de contrôle apparaissent insuffisants. Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE), pourtant signé par une grande majorité d’États, n’est toujours pas en vigueur, faute de ratifications clés, notamment de la part des États-Unis, de la Chine et… de la Corée du Nord.
Le Conseil de sécurité de l’ONU est quant à lui paralysé. La Chine, désormais alliée tacite de Pyongyang, refuse toute sanction supplémentaire, à moins d’obtenir des concessions américaines ailleurs – par exemple, un retrait des missiles balistiques américains d’Asie.
Le silence de l’abîme, le vacarme du monde
Le sous-marin nucléaire nord-coréen est le symptôme d’un désordre mondial, où les logiques de puissance l’emportent sur les mécanismes de régulation. Il reflète un monde où les alliances opportunistes, les intérêts économiques et les calculs géopolitiques prennent désormais le pas sur les normes collectives. Il est aussi un signal d’alarme. Car si la Corée du Nord parvient à rendre opérationnelle une force de dissuasion maritime, d’autres suivront. L’équilibre nucléaire global, déjà précaire, pourrait s’effondrer sous le poids de cette prolifération silencieuse.
Dans ce contexte, il ne reste qu’une issue : reprendre le chemin du dialogue. A l’instar des propositions d’IDN, il faut impliquer toutes les puissances nucléaires dans un processus multilatéral, transparent, progressif, réactiver les mécanismes de vérification et surtout, recréer une volonté politique commune. Car sans cela, le silence des océans pourrait, un jour, être brisé par le fracas de l’irréparable.